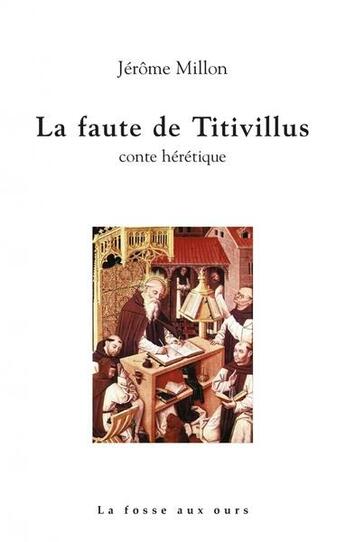L’itinéraire d’un simple entre 1436 et 1489, en pays breton, au temps des scriptoriums et des moines copistes que vient ébranler l’invention de Gutenberg. Aventure individuelle ou révolution culturelle ? Un conte philosophique.
Quand un chat décide du destin d’un nouveau-né : incipit
« Né dans une famille de pêcheurs, il aurait dû, dans la barque paternelle, avec ses deux frères, affronter la mer comme tous ses aïeux avant lui, si le chat ne s’était chargé d’infléchir la droite ligne de cette destinée. » (p.20).
C’est ainsi qu’Odilon, sans élan particulier vers le Ciel, entre, à 15 ans, le 22 avril 1451, au monastère de Saint-Gobrien. Dans un monde régi par la Règle, affecté d’abord au jardin, « un potager qui exhalait la discipline d’un traité de droit canonique » (p. 41), ensuite à l’entretien de l’étang, avant d’accéder au scriptorium, il est fait moine, le temps venu. Un « sans faute » pourrait-on dire si on ne craignait l’abus de langage. Soucieux de toujours bien faire, il s’applique s’évertue, réussit, se sent « à sa place » dans la clôture rassurante d’un lieu qui exclut le doute. Sur l’échelle de perfection, il gravit les échelons. Vers quel sommet ? Nous voici dans un conte, le sous-titre en décide, un conte initiatique dont le héros, néanmoins, dépasse la cinquantaine quand nous le quittons à la page 189. L’apprentissage a été long, un peu comme celui de Candide, l’Odilon de Voltaire qui met bien des années et des mésaventures avant de comprendre qu’«il faut cultiver notre jardin ».
Sur les terres de Bretagne
Le décor est planté, au cœur du Morbihan, entre terre et mer, sur un territoire bien ancré dans la réalité, la nomenclature des lieux en témoigne, entre Saint-Gildas-de-Rhuyz et Saint-Gobrien en passant par Vannes ; mais aux yeux d’Odilon, « le monde s’offrait comme un livre de merveilles » (p. 21). Jérôme Millon tourne les pages de ce livre : elles disent la beauté du monde, sa poésie et son subtil arrimage au merveilleux :
« …s’il appréciait les salicornes, les liserons des sables et le muscari, le chardon bleu avait sa préférence. […] Enraciné dans le sable, le chardon semblait se nourrir de ses cristaux, donnant à ses feuilles leur structure cuirassée et à ses épines le tranchant de l’épée. Le fruit glorieux piqué d’aiguilles s’épanouissait en son centre, protégé par ces sentinelles armées. Quel précieux secret portait-il donc ? L’Ordre du monde, dans la distribution des qualités, a manifestement fait preuve d’un peu de fantaisie en donnant à cette plante aux attributs guerriers des couleurs bien pacifiques, du tendre bleu pâle à l’outremer. Le noir n’aurait-il pas mieux convenu ? » (p. 21).
D’autres surprises attendent le lecteur, des rencontres tout droit sorties du bestiaire fantastique médiéval : un hérisson, une carpe, un crapaud. La magie du conte opère.
Quant au héros lui-même, lancé dans l’aventure de la vie monastique, comme d’autres moussaillons sur les mers dans le corpus des légendes bretonnes, il doit plus humblement faire ses preuves pour être admis dans la communauté, au jardin, au bord de l’étang jusque dans le scriptorium et en même temps y éprouver la solidité de sa foi.
Les étapes d’un apprentissage : un long cheminement vers la perfection ?
Ce n’est pas si simple car, avec Jérôme Million, le mieux est peut-être l’ennemi du bien ! L’adage, qu’il soit de Montesquieu ou de Voltaire, est au cœur de sa réflexion de conteur philosophe. Il offre à son héros une occasion en or de tester son désir entêté de mieux faire : l’entrée dans le saint des saints, le scriptorium du monastère où, très vite, il excelle. Aussi bon copiste qu’il fut jardinier, d’abord chargé de la réglure, le tracé impeccable de ses parallèles le mène à une imprudente conclusion :
« il fallait se rendre à l’évidence : seule la main de l’homme pouvait tracer ces parallèles, et il y avait là une excellence propre à la Créature, peut-être même sa signature. » (p .94).
Là où la nature pouvait se jouer de la compétence du jardinier, la plante germer ou ne pas germer, dans le silence du scriptorium, l’activité seule du copiste est garante de la perfection de la copie. La tentation est grande alors pour Odilon, l’ingénu, de gravir ce dernier échelon. Les Grecs nommaient hubris toute orgueilleuse idée de soi et la punissaient ; la théologie chrétienne en a fait un des sept péchés capitaux. Si le mieux est l’ennemi du bien, ne serait-ce pas tout simplement parce que l’un et l’autre ne relèvent pas du même ordre, celui de l’humain pour le premier, du divin pour le second. À nous, lecteurs libres-penseurs, de choisir. Et d’entrer ou pas dans ce débat où l’excellence atteinte relèverait de l’impensable sacrilège, et son éloge de l’hérésie.

Jérôme Millon suggère une autre lecture de ce fanatisme de la perfection, enrichissant, par là- même, la palette des interrogations de son héros. « Citius, Altius, Fortius » : le mieux n’est peut-être pas l’ennemi du bien, mais il appelle récompense et, si elle ne vient, déception et vengeance, toutes passions dont le héros sent la morsure ! Faute d’être reconnu dans sa pratique du bien, il choisit d’exceller du côté du mal. Inventif et malicieux, le conteur introduit alors l’instrument de cette métamorphose, Titivillus. Si le diable est dans les détails, Titivillus, dans l’imaginaire médiéval, est un de ces détails : le diablotin est chargé de récolter, toutes les nuits, les ratés des copistes ; ils leur seront imputés lors du Jugement dernier. Son irruption met un terme à l’envoûtante léthargie du monastère et relance l’intrigue avec une savoureuse insolence. A l’Ordre, succède le Désordre : les fautes se muliplient sur les feuillets, Odilon, passé maître d’un caviardage vengeur, la réputation de Saint-Gobrien sur le marché du manuscrit est ébranlée, le sérieux des copistes discrédité, leur mission de passeurs, dégradée. Le mieux et le pire ne sont que les deux faces d’une même dangereuse excellence. Propos hérétiques évidemment !
Son aboutissement : l’éloge de l’imperfection
Il fallait au conte une dernière étape, au héros, un dernier voyage pour assurer la cohérence du récit et lui donner un sens. Illusions perdues, l’esprit peut s’ouvrir à notre condition bancale, la vie devenir existence.
« Odilon ne croyait plus au mérite.
Odilon ne croyait plus à la promesse divine de récompense.
Odilon ne croyait plus aux textes.
Odilon ne croyait plus. » (p. 130)
Odilon quitte définitivement le monastère, désormais moine gyrovague, pour un voyage de retour, plein d’usage et raison, qui le fait passer par Vannes, la cité grouillante de vie. Humaine, très humaine ! Trois rencontres décisives décident de sa conversion au monde. L’homme y est de chair autant que d’esprit ; ouvert au changement, en ces années où l’imprimerie transforme en erreurs de la machine les fautes imputées naguère au copiste ; où l’Humanisme libre penseur lie paradoxalement confiance en l’homme et reconnaissance de sa faillibilité. L’auteur fait vivre en quelques pages cette mutation essentielle. du sacré au profane dans la diffusion du savoir dont quelques-uns, plus clairvoyants, mesurent le caractère inéluctable et positif. Au temps immobile des monastères succède celui de la ville et de l’Histoire en marche. Le discours n’est plus le même : place au débat enthousiaste et au pari sur l’avenir, dans l’incertitude vivante. Les derniers porte-parole de Jérôme Millon sont des hommes de la Renaissance.
« La perfection à laquelle tu aspires n’existe pas. C’est heureux qu’il en soit ainsi. L’atteindre serait ton plus grand malheur. C’est ta vie même qui se déroberait. La vie est mouvement, effort, espoir ; tu as parcouru moult chemin, et si certains t’ont mené dans une impasse, tu as toujours trouvé la clef d’un autre destin. La perfection atteinte, figée dans son absolu, n’a d’autre perspective que de se reproduire dans un infini mortifère. » (p. 171).
On attend souvent le conteur à la « chute » du récit. L’écrivain s’est pris d’affection pour son personnage et le conduit, rasséréné, au pays de son enfance, vivre auprès de son frère le reste de son âge ! Fin du voyage, fin du conte. Hérétique ? La réponse est à chercher dans une dernière question que se pose le héros : « D’où se juge-t-on ? ». Une belle leçon de vie dans l’esprit du conte philosophique. Un moment de lecture jubilatoire.
Conversation à bâtons rompus entre Jérôme Million,
Marie-Thérèse Devèze et Claudine Bergeron.
Bibliographie

Jérôme Million est éditeur à Grenoble d’une prestigieuse maison d’édition qui publie depuis 1985 des ouvrages de philosophie, religion, histoire et préhistoire.
Éditions Jérôme Million : maison d’édition en Sciences Humaines.
Deux romans parus à La Fosse aux Ours :
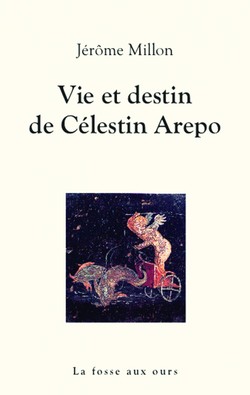
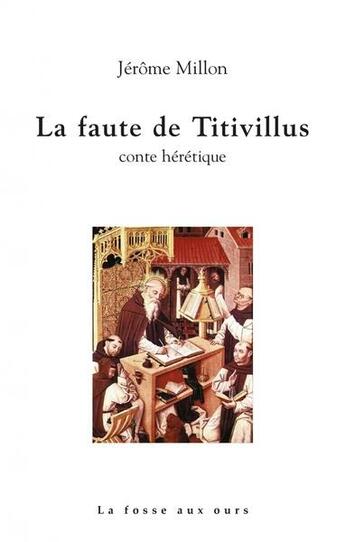
Pour faire le lien entre ces deux textes, on peut lire la dernière phrase de leur quatrième de couverture : Célestin ou l’éloge de l’incertitude pour le premier, Titivillus ou l’éloge de l’imperfection pour le deuxième. Leurs analyses sont sur le site Les-notes.fr