Daniel Cohen et son livre posthume
Daniel Cohen, agrégé d’économie et de mathématiques, normalien, professeur d’université, directeur du département d’économie à l’École normale supérieure, président et co-fondateur de l’École d’économie de Paris, est l’auteur de plusieurs best-sellers chez Flammarion : Richesse du monde, pauvreté des nations (1997), Nos temps modernes (1999) ; et aux éditions Albin Michel : La prospérité du vice (2009), Homo economicus (2012), et Homo numericus (2022). Son dernier essai, Une brève histoire de l’économie paru chez Albin Michel après sa mort survenue en août 2023, est une synthèse de ses analyses passées destinée à les mettre à la portée de tous. L’auteur n’a pas eu le temps de finaliser ce livre qui paraît en l’état, comme une série de rushs (c’est son frère qui le dit en postface car Daniel était fan de cinéma) prélude à un grand projet : une bande dessinée balayant l’aventure du développement économique. Le livre est préfacé par Esther Duflo, prix Nobel en 2019 pour son étude sur la lutte contre la pauvreté.
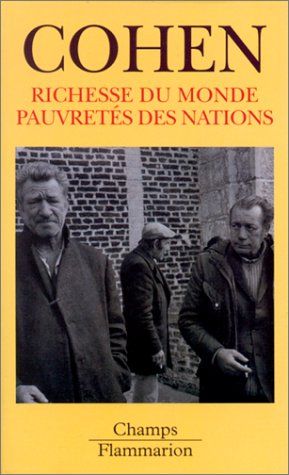
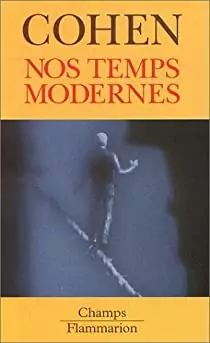

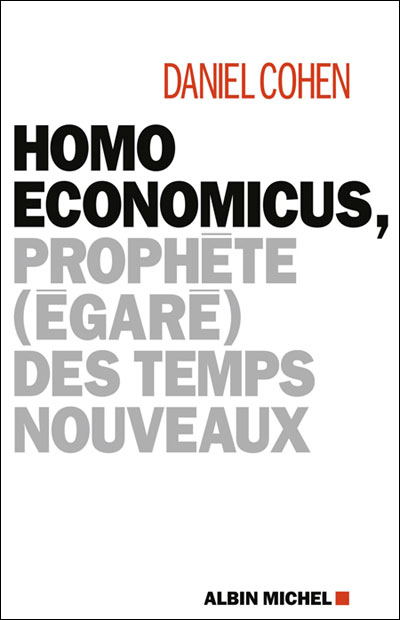
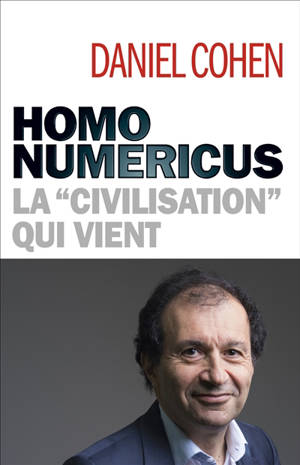
LE CONTENU illustré par quelques extraits
Genèse
L’invention dans le Croissant Fertile de l’agriculture et de l’élevage est ancienne.
« Mais le paradoxe de la civilisation agraire est donc celui-ci : l’agriculture, faite pour mieux nourrir les humains débouche (partout) sur une société où règne la famine ! L’histoire économique apparaît, sous ce jour, comme une sinistre alternance d’expansion et de crises. Expansion quand les ressources abondantes libèrent la démographie. Crises lorsque l’élan démographique bute sur la rareté des ressources ».
(loi de Malthus)
Prométhée libéré
Vers le milieu du XVIIIe siècle en Angleterre, le progrès technique, en particulier la machine à vapeur, révolutionne l’industrie qui grâce à la hausse du niveau de vie déclenchera la transition démographique : la baisse de la mortalité entraîne à terme celle des naissances.
Par quel processus ?
« La course de la croissance tire les secteurs en retard jusqu’au point de rupture, provoquant des innovations qui brisent l’équilibre antérieur et prennent parfois une course autonome. Un déséquilibre chasse l’autre, mais cette course entraîne in fine la croissance d’ensemble ».
Grâce aux secteurs de pointe, textile, transports, la Grande-Bretagne qui possède le charbon, énergie de la première industrialisation, s’ouvre au commerce international pour écouler ses produits manufacturés excédentaires à l’étranger en échange de matières premières et agricoles. C’est la première division du travail à l’échelle mondiale.
L’économie du XIXe siècle est régie par le marché qui est théorisé par Adam Smith. Chacun guidé par son propre intérêt se spécialise dans l’activité pour laquelle il est le mieux placé et achète ce qui lui manque aux autres, c’est la « main invisible » qui divise le travail au profit de tous. Mais l’industrie naissante fait des victimes, les ouvriers. Marx démontre que les travailleurs sont exploités : ils ne reçoivent qu’une partie des richesses qu’ils créent, le produit de leur surtravail est confisqué par les propriétaires du capital qui ne paient les ouvriers qu’un minimum grâce à l’armée de réserve que sont les chômeurs pour prélever un profit. Schumpeter isole un troisième facteur, le progrès technique qui permet d’accroître la productivité. Mais c’est un processus de destruction créatrice. Les structures de l’économie sont périodiquement bouleversées au détriment de ceux qui ne peuvent trouver du travail dans les nouveaux secteurs.
Prospérité et crises
Après une croissance brillante succédant à la Première Guerre mondiale, la crise de 1929 née aux États-Unis amorce une longue période de dépression qui atteint tous les secteurs et se propage à l’extérieur. Le krach boursier issu d’une spéculation effrénée provoque des faillites en chaine, aggravé par une politique d’orthodoxie financière contre-indiquée et la fermeture des frontières qui entraine la rétorsion. Le chômage atteint un quart de la population en 1933 aux USA.
« …les autorités monétaires vont chercher à rassurer les déposants et les spéculateurs en maintenant aussi longtemps que possible la convertibilité de leur monnaie en or. Cela oblige à maintenir les politiques restrictives pour réduire les besoins de financement. A contrario, dès qu’un pays abandonne le système de l’étalon-or, la croissance repart et les capitaux affluent. »
En 1936, à l’approche en terme d’offre censée toujours créer sa propre demande se substitue le rôle de la demande. C’est la révolution keynésienne. Le marché sans contrôle est incapable de réguler l’économie. La mise en place de l’état-providence dès le début de la seconde guerre et les déficits budgétaires alimentent la consommation.
L’âge d’or et sa crise
Et après-guerre, c’est l’âge d’or. L’augmentation de la productivité permet d’augmenter le niveau de vie et la consommation qui dope l’investissement. Mais ce régime de forte croissance en Occident est remis en cause par deux chocs pétroliers qui renchérissent les coûts. La stagflation « mélange inédit d’inflation et de récession » remet en cause la « courbe de Philips » qui relie inversement hausse des prix et chômage et décrédibilise les politiques de relance keynésienne. En outre dès 1980 émerge un nouveau capitalisme financier. Négligés au profit des salariés à la suite de la crise de 1929, les actionnaires reprennent la main. La bourse dicte sa loi. Pour baisser les coûts les entreprises externalisent les activités les moins rentables vers les pays à bas salaires. Ce qui brise l’unité du monde ouvrier. Et fait exploser les inégalités. (cf. Thomas Piketty) alors que les années d’après-guerre les avaient réduites.
Le système financier
En effet les ultra-libéraux prônent le retrait de l’État et la dérégulation tous azimuts. C’est le big bang des marchés financiers.
Naissent de nouveau intermédiaires financiers, les hedges funds, qui achètent à crédit des entreprises non cotées à risque. Et les banques accordent des prêts à leurs clients sans trop de souci de leur solvabilité puisqu’en les « titrisant » elles peuvent les revendre sur le marché. C’est là qu’elles s’approvisionnent désormais en liquidités. Or pour faire du chiffre, la qualité des crédits se détériore. C’est la crise des subprimes en 2008 déclenchée par une hausse des taux directeurs. Mais la FED, forte de l’expérience de 1929, vient au secours des banques en difficulté et évite le pire. L’intervention de l’État est indispensable comme l’avait souligné Keynes.
« Le mirage d’un monde laissé aux seules forces du marché a, de fait, été abandonné. »
La mondialisation
Parallèlement, l’ouverture des frontières aux produits matériels et financiers engendre une nouvelle division du travail à l’échelle mondiale.
« Aux pays pauvres, la fabrication des produits industriels, aux pays riches, leur conception en amont et leur commercialisation en aval. »
La Chine s’insère dans les échanges et exporte des biens compétitifs puisque la main d’œuvre est encore peu chère. Son armée de réserve vient de l’exode rural. Confiscation de la démocratie en échange d’un enrichissement (inégal) à outrance.
La révolution numérique
Au XXIe siècle, l’intelligence artificielle change encore la donne. Fourastié prédisait que la machine libèrerait l’homme des tâches les plus ingrates, une société majoritairement tertiaire annoncerait un monde sans croissance.
« Si le bien que je vends est le temps que je passe pour autrui, sauf à travailler toujours plus pour gagner plus, la croissance doit s’éteindre ».
Mais cela permettrait d’avoir plus de temps libre dédié à la culture, un « troisième âge ». C’était sans compter la façon dont nous utiliserions nos richesses, jamais suffisantes. Et, fait nouveau, la révolution numérique accroit l’efficacité des services jusqu’ici peu productifs et réduit les coûts d’interaction entre humains, ce qui relance l’économie. Mais au prix d’une certaine déshumanisation des rapports entre individus et de conséquences comme la baisse de l’attention et du sens critique.
Le krach écologiste
Notre type de croissance détruit la planète. Le réchauffement climatique est né de la dépendance des industries et transports aux énergies fossiles, et de la déforestation. Les gaz à effet de serre piègent la chaleur comme le fait une serre.
« Selon les estimations du GIEC, 85% de notre budget carbone est déjà consommé ».
Il faut à tout prix limiter la hausse des températures à 1,5%. Sous peine de voir exploser les désordres présents jusqu’à l’effondrement de notre monde. Le mode de vie occidental n’est pas extensible à la planète. Les remèdes sont connus. Mais ils se heurtent au fait que beaucoup font passer d’autres priorités avant l’écologie et que la solution épineuse exige de préférer la rationalité à la performativité et d’instaurer une coopération à l’échelle mondiale.
Le Bonheur national Brut
Nos sociétés occidentales se sont considérablement enrichies, ce qui a contribué au bien-être. Plus de nourriture, plus de biens durables, plus d’éducation, de soins et de culture. Mais la consommation est comme une drogue, on s’y habitue.
« Ce sont les variations du revenu qui rendent heureux, mais la satisfaction qu’on tire d’un revenu plus élevé s’évapore rapidement ».
Nous sommes plus avides de croissance que de richesses. Si elle ralentit, la frustration revient. Chacun se compare aux autres et surtout à son groupe de référence. L’envie est la malédiction de nos sociétés. Le but du développement est le bonheur alors qu’il ne devrait être que la récompense d’une bonne vie. Ce qui suppose de préférer les biens qualitatifs comme d’avoir un but dans l’existence ou l’altruisme, aux biens matériels qui aiguisent la rivalité sociale. Cultivons la sagesse qu’apporte souvent l’âge, cessons d’accumuler des produits inutiles, ce sera bon pour la planète et notre bonheur.
LA CRITIQUE
Il est vrai que ce livre ne délivre pas de messages nouveaux. Mais tel n’est pas son but. C’est un ouvrage de vulgarisation qui rend intelligible une histoire largement ignorée par la majorité des Français. Il est très succinct pour ne pas lasser, ce qui a une conséquence : parfois le raccourci omet des faits ou des idées importantes. Par exemple le New Deal n’est qu’esquissé. Mais il est rare de lire un exposé aussi clair, aussi utile pour les non-initiés que pour tous.
Il est vrai aussi que les remèdes suggérés n’ont rien de révolutionnaires. L’auteur puise dans une bibliographie savamment choisie pour rappeler les solutions. Qu’elles relèvent de l’utopie est certain, ce qui ne retire rien à leur nécessité. L’espérance en l’avenir suppose une vision optimiste des capacités humaines.
Ce qui est remarquable, c’est la construction de cet ouvrage pourtant inachevé. Chaque phase de l’histoire est suivie et non précédée des théories économiques les plus marquantes. Parce que la situation présente lue avec des lunettes provenant des idées passées et l’échec des politiques tentant de reproduire l’hier aggravent les difficultés. Les remèdes adoptés naissent sur le tas avant la pensée des économistes. L’œuvre majeure de Keynes, la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, date de 1936 seulement. Les idées de Keynes ont davantage inspiré les politiques de l’après-guerre et permis en partie les trente Glorieuses mais se sont avérées incapables de traiter des situations nouvelles, du fait même de leur succès qui a engendré des dérives.
De même l’ordre dans lequel Daniel Cohen expose les diverses étapes de la croissance est judicieux. La révolution industrielle précède la révolution agricole. La mondialisation naît de la révolution ultra-libérale qui explique les crises financières. Quant au progrès technique, il permet le toujours plus mais participe à la dégradation de l’environnement. Les divers chapitres sont très bien reliés entre eux de telle sorte que l’on a l’impression que l’histoire est un flux continu.
C’est un panorama complet et accessible en cent-soixante pages aérées qui répond à la question posée en introduction : la croissance est devenue un but en soi, seule source supposée du bonheur. Or elle est de plus en plus faible et intermittente. Nos sociétés sont six fois plus riches qu’à l’époque de Keynes mais plutôt que de travailler moins, nous avons pris l’option de la fuite en avant. Or pourquoi désirer toujours plus, malédiction qui n’engendre pas davantage de satisfaction et compromet l’avenir de la planète ?
À mettre entre toutes les mains pour réfléchir aux défis gigantesques actuels.
Laurence Guiral, lectrice du comité adulte
mars 2024
Daniel Cohen, Une brève histoire de l’économie. Albin Michel, février 2024

