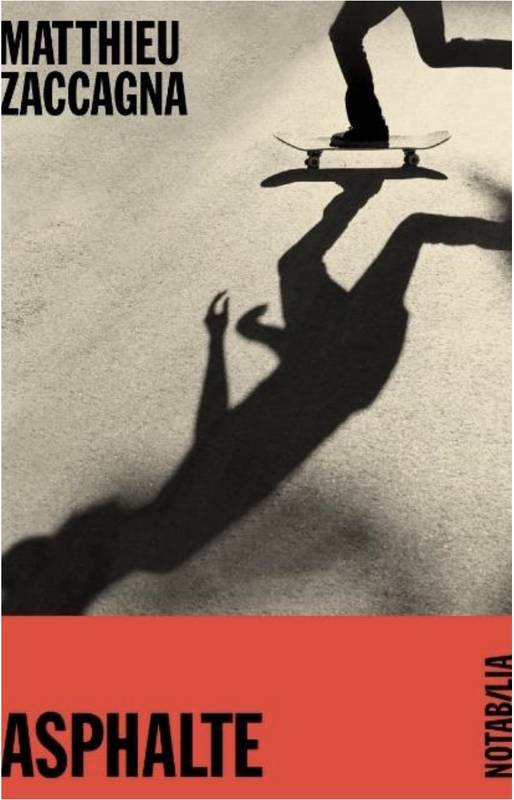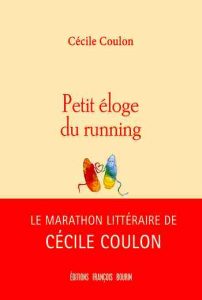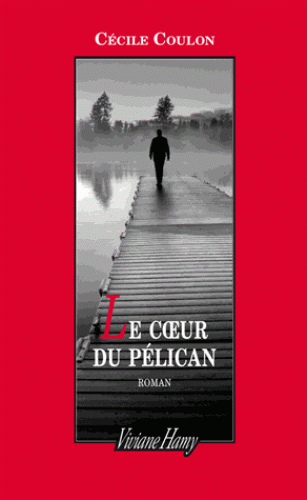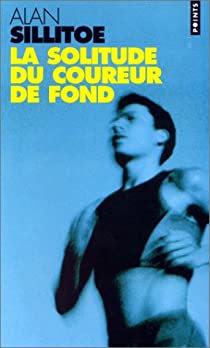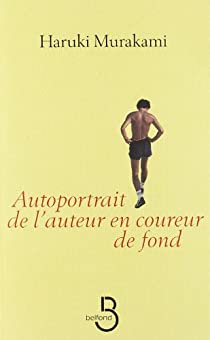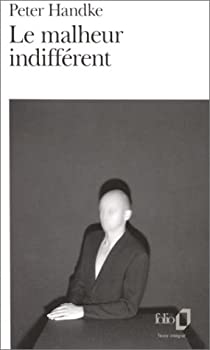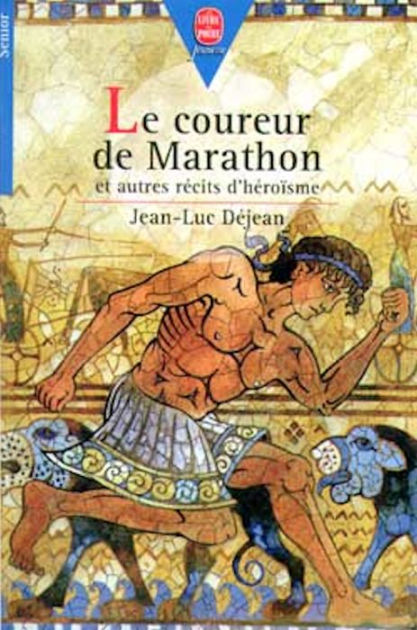Un premier roman, comme un écho au Petit éloge du running de Cécile Coulon : « … en course, lorsqu’on part sans se poser de question, il arrive souvent qu’on trouve une réponse sur sa lancée. » Sait-on ce qui nous fait courir ou ce qui fait qu’on écrit ?
Asphalte ? C’est une centaine de pages rythmées par le bruit des roues d’un skate sur l’asphalte parisien pour raconter une histoire de course :
« Courir déterminé, en un bloc solide, résistant. Se faire violence, serrer les dents, plisser les yeux, broyer l’asphalte. (…) J’avance dans les quartiers nord de la ville. Mes cuisses sont en vrac. Mes genoux pareil. Je ne m’arrête pas. J’abîme la douleur. Dans l’aube naissante, la brume se dissipe sur l’eau du canal. J’ignore combien de temps je vais pouvoir tenir comme ça. » (p.9)
La réponse vient à la toute fin :
« Je n’éprouve plus de peine, plus de pesanteur. Je m’isole de moi-même, me fais l’effet d’un rescapé. » (p.125).

De quoi inscrire ce premier roman de Matthieu Zaccagna dans la lignée de La solitude du coureur de fond d’Alan Sillitoe, de L’autoportrait de l’auteur en coureur de fond de Murakami et sans doute aussi du Cœur du Pélican de Cécile Coulon. On peut évoquer également la course mythique du Philippidès entre Marathon et Athènes, à l’origine de toutes les courses d’endurance. Autant de textes qui interrogent les raisons qui nous font courir ou arrêter net de courir, au gré des problématiques qu’ils abordent. Matthieu Zaccagna nous y invite puisque, dit-il, son objectif premier était de mettre en mots les sensations de la course, lui-même adepte du skate et de ses marathons. Voilà pour le terreau d’Asphalte ! Ou presque… car, le défi de l’écriture étant de faire entendre les battements de cœur de celui qui dévale à pleines rues les pentes de Ménilmontant, il fallait, au pupitre, un musicien : passionné de musique de jazz, l’auteur travaille la rythmique de ses phrases comme le batteur d’un orchestre :
« Mon objectif ? Le rattraper (il s’agit de Rachid son coéquipier). Me sentir proche du son de la planche. Son violent, rassurant, broyant l’asphalte. Je respire haut. Broyant mon torse. Rachid en ligne de mire. Je suis mes jambes ; m’en remets à elles. M’enfouis dans mon animalité. Fonds sur ma proie. Atteins presque Rachid. Avale le son du skate. » (p.50).
Le rythme syncopé des phrases courtes, dégraissées de toute fioriture, ramène à l’essentiel : la note juste, percutante, haletée.
Mais au roman il faut autre chose que la poésie rude du vent de la course. Le roman a besoin d’une histoire ! Qui est donc ce narrateur dont les folles descentes structurent le récit ? Victor a dix-sept ans. Il se raconte dans une sorte de monologue où le passé alterne avec le présent par séquences juxtaposées comme autant d’éclats de douleur ou de cris de révolte. Un père, Louis, monstrueusement violent, une mère aimante, Agnès, première victime de cet homme dont elle n’est pas parvenue à protéger son fils. Le scénario est d’une atroce banalité ! Sa force tient à la construction des trois personnages : le premier, qui se pique d’être écrivain, impose à sa femme puis à son fils de relire à voix haute les pages quotidiennes de son manuscrit dans lequel il fantasme leur mort, au paroxysme d’une ivresse démente. Quintessence de cruauté et de pitoyable impuissance. Avec Agnès, emblématique du consentement de la victime à sa démolition, le texte atteint une dimension poétique déchirante quand elle imagine avec son fils et pour lui un ailleurs merveilleux, un monde de planètes dessinées sur des feuilles de papier format A4, leur destination prochaine ! Des moments d’évasion touchants mais tellement douloureux si on prête attention aux noms qu’elle donne à ces planètes : Zweig, Bernhard et Rilke qui signent sa désespérance et la pudeur avec laquelle elle est mise en scène. La longue référence au roman de Peter Handke, Le malheur indifférent. en page d’ouverture dit, de la même manière allusive, la place d’Agnès dans le dispositif romanesque :
« cette lumière tremblante, mal réglée, sans éclat, insuffisamment rassurante, dans l’ombre de Louis, un repère lointain, approximatif. » (P.105).
L’évocation du passé qui alterne jusqu’au bout du roman avec l’énergie du présent est d’une infinie tristesse. L’écriture s’en fait lyrique, le phrasé, moins heurté :
« Les arbres éclairés par la lune dessinent des ombres inquiétantes sur mon corps. J’entends le bruit de la mer qui se retire au loin.je m’imagine porté par l’écume et lorsque je me vois dans cet état, je me dis que ce doit être ça, la musique d’éternité, le bruit de la mer qui gronde au loin. » (P.57).
Louis, Luigi, papa, Agnès ou maman, l’alternance des prénoms d’un bout à l’autre du roman dit aussi, subtilement, combien ce couple désarticulé n’a jamais pu fonctionner, encore moins faire famille. Pour l’adolescent, livré à la folie du père, une seule issue, la fuite, une errance dans Paris, une fugue définitive. Elle donne un sens à la course, son point de départ, elle installe une dynamique romanesque.
Asphalte est le roman d’un arrachement au malheur, tissé de peur, de colère et de moments d’apaisement : trois tempos différents. La peur et la colère colorent le rythme du skate d’un jusqu’auboutisme désespéré de trompe-la- mort : la prise de risque permanente n’est pas celle d’un banal adolescent qui flirterait avec les limites ; elle est une thérapie libératoire de l’emprise :
« La douleur impérative, nécessaire, donne un sens à l’effort furieux. Sans douleur, pas de course. Je cours sale. M’échappe de moi, m’agresse. » (P.42)
Les pauses, en contrepoint, sont d’une infinie douceur, dans un monde de la rue dessiné sans angélisme ; les trois personnages placés sur la route du héros y pratiquent la vertu essentielle d’une empathie sans geignardise. Quand Justine l’interroge : « Tu misères depuis longtemps ? », Victor n’est pas sommé de répondre : Il « imprécise » ; lui que Rachid a surnommé Capuche a enfin droit au secret. Il a droit aussi à l’oubli de son passé calamiteux et toxique non dans une trompeuse amnésie mais dans sa relégation temporaire. Le temps du souvenir est pour plus tard. L’analyse est fine de ce qu’on nomme aujourd’hui, à tort et à travers, résilience. Elle sonne juste, même dans la voix du jeune narrateur car l’auteur invente une langue à l’abri des clichés du parler-de-la-rue, aussi pittoresque que vraie dans ses dialogues comme dans le monologue intérieur.
Un premier roman d’une écriture parfaitement maîtrisée. On est happé par ce beau texte incisif et sensible qui impose au lecteur sa respiration. On est pris surtout et constamment par une cohérence formelle qui inscrit rigoureusement un récit de vie avec ses retours en arrière, exhalés littéralement, comme expulsés, dans le présent répété d’une course. Oubliés ici les flashs back si souvent artificiels tant l’adéquation est parfaite entre la forme et le fond pour articuler deux temporalités. La forme est première quand la manière d’écrire détermine la justesse de ce qui est dit. Ecoutons une dernière fois la scansion parfaite de cette séquence :
« Des larmes. Je pense. Je me calme. Je comprends. Pour la première fois, j’accepte ce qui, jusqu’ici, m’apparaissait intolérable. J’accepte la haine infinie qu’éprouve mon père pour moi. » (P.113)
Un grand merci à Matthieu Zaccagna pour le temps qu’il m’a consacré à parler de ce roman et de la discipline que lui a imposée son écriture chronophage : un temps dédié de 45 minutes par jour pour mener à son terme ce premier marathon littéraire…
Claudine Bergeron, lectrice Hors Champ
Asphalte, de Matthieu Zaccagna , Noir sur blanc (Notabilia)
Bibliographie des textes cités
Cécile Coulon : Petit éloge du running, François Bourin (mars 2018)
Le cœur du pélican, Viviane Hamy (février 2015)
Alan Sillitoe : La solitude du coureur de fond, Seuil (février 2000)
Haruki Murakami : L’autoportrait de l’auteur en coureur de fond, Belfond (février 2001)
Peter Handke : Le malheur indifférent, Gallimard (septembre 1977)
Jean-Luc Déjean : Le coureur de Marathon et autres récits héroïques, Livre de poche jeunesse (juin 1988)